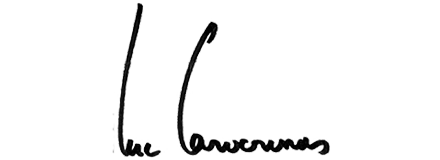« Ni Dieu ni maître » est la nouvelle devise de Luc Carvounas, un ancien proche de Manuel Valls. Le sénateur-maire d’Alfortville, candidat aux législatives, prône un dialogue entre les composantes de la gauche en désaccord avec le nouveau pouvoir.
Il était un bon petit soldat de la majorité. Mais pour Luc Carvounas, « c’est fini ». Sa nouvelle devise est « ni Dieu ni maître ». L’expression est lâchée avec malice par un élu connu pour avoir été l’un des porte-flingues de Manuel Valls. Au-delà du bon mot, et d’une prise de distance publique sur le quinquennat finalement très récente, Luc Carvounas revendique sa nouvelle « liberté », lui qui n’a pas suivi son ancien mentor dans la « majorité présidentielle ».
Il revient sur la droitisation et les erreurs politiques du quinquennat, comme la déchéance de nationalité ou la loi sur le travail. Critique du nouveau gouvernement, le sénateur et maire d’Alfortville (Val-de-Marne), candidat aux législatives, assume son attachement au « socialisme ». Un attachement qu’il puise, notamment, dans son histoire personnelle et ses expériences de la minorité – ce binational franco-grec est le premier parlementaire à s’être marié avec un homme.
Attaché à l’union de la gauche, il entend rebâtir « une maison commune », un « parti des démocrates », à partir des expériences menées dans les territoires et d’un dialogue ouvert, des communistes aux radicaux en passant par les socialistes et les écologistes.
Mediapart : Que pensez-vous du nouveau gouvernement ?
Luc Carnouvas : Emmanuel Macron fonctionne comme un homme d’affaires. Il a créé une start-up (En Marche!) qu’il a fait progresser par des fusions-acquisitions (avec le MoDem), qu’il a transformée après avoir réussi son coup (changement de nom pour « La République en marche » aux législatives), avant de lancer une OPA sauvage sur LR et le PS. C’est un fonctionnement du monde des affaires, avec le cynisme de ce milieu. On l’a vu, par exemple, à la colère de François Bayrou concernant les investitures aux législatives.
Avant, on parlait d’« ouverture » ; maintenant, on parle de « recomposition ». Tout cela me paraît bien immodeste. Je rappelle d’abord que le président a réuni 24 % au premier tour, c’est-à-dire moins que ses prédécesseurs en 2012 et 2007, et qu’il a été plutôt mal élu au second tour. Ensuite, le gouvernement Philippe est assez âgé en moyenne, sans beaucoup de diversité, avec des professionnels de leurs secteurs. Il s’agit surtout de l’hystérisation de la prise du pouvoir par l’énarchie, que ce soit à la tête de l’exécutif, parmi les ministres ou dans les cabinets ministériels.
Ce gouvernement peut plaire aux Français pendant un temps, parce que les gens en ont marre du sectarisme, et qu’on s’oppose pour s’opposer. Mais ils en ont marre aussi des béni-oui-oui, le doigt sur la couture du pantalon, qui votent des textes préparés par la technostructure. C’est d’ailleurs pourquoi, alors que j’étais un des piliers de la majorité, je n’ai pas crié au loup contre les frondeurs. On ne peut pas vouloir un Parlement du non-cumul et être exaspéré par des parlementaires qui veulent peser dans la discussion.
Au passage, j’ai bien compris que le nouveau pouvoir souhaitait faire taire certaines voix fortes du Parlement. Qu’on vienne m’expliquer pourquoi LREM [La République en marche – ndlr] met des candidats contre Seybah Dagoma, Najat Vallaud-Belkacem, Pascale Boistard ou Matthias Fekl ? Où est la République bienveillante pour ces figures de gauche respectées, qui ont l’assentiment de l’opinion publique depuis longtemps ? La vérité c’est que, pour Macron, aucune tête ne doit dépasser. C’est d’ailleurs
la première fois que le secrétaire d’État aux relations avec le Parlement est un proche du président, et pas du premier ministre. Ça promet.
Mais ce poids de l’énarchie, cette arrivée au gouvernement de ministres qui disaient le contraire la veille de ce qu’ils sont censés soutenir, est-ce si nouveau ?
Non, pas du tout ! Mitterrand l’a fait, Sarkozy l’a fait… Mais selon moi, le macronisme est le comble de l’alliance de la carpe et du lapin. Il hystérise la salade macédoine.
Je suis attristé par ceux qui tournent le dos à leurs valeurs. Beaucoup ont leur carrière derrière eux, et sont des personnalités qui ont cumulé les mandats dans le temps, comme François Patriat ou Gérard Collomb. Quant à Richard Ferrand [ministre de la cohésion des territoires – ndlr], il était emmanuelliste ! À l’époque de la loi Macron, l’actuel président n’en voulait pas parce qu’il n’avait pas confiance dans ce type étiqueté « aile gauche du PS », qui a finalement été envoûté. Tant mieux pour lui, mais enfin il n’est pas interdit d’avoir des convictions dans ce pays !
Pour ma part, je ne suis pas attaché au PS en tant que tel, car ce n’est pas un fétiche ou une relique. Je suis attaché à l’idée du socialisme et de la gauche. La gauche continue d’exister : elle fait 30 % au niveau national, elle existe à Alfortville, dans le Val-de-Marne, à Paris, à Rennes, à Nantes, en Occitanie… Tout cela serait balayé à cause d’une élection ? Non.
Le PS vient pourtant de faire un score historiquement faible à la présidentielle, avec 6,36 % des voix…
Il était clair qu’on ne pouvait pas gagner, notamment à cause du manque du soutien dont on a pâti, y compris des donneurs de leçons actuels comme Stéphane Le Foll, qui est resté silencieux jusqu’au bout de la campagne.
J’en retire pourtant un enseignement positif : désormais, on se parle tous. Jusque-là, et moi le premier, nous étions dans des écuries et des chapelles. Là, je me retrouve à une même table avec François Lamy, Guillaume Balas, Gérard Filoche, Najat Vallaud-Belkacem… Notre socle commun, c’est l’idée qu’on se fait du socialisme. Ma responsabilité, avec d’autres, c’est de ne pas quitter le navire, notamment pour ne pas abandonner la gauche à Jean-Luc Mélenchon, qui a refusé d’appeler clairement à voter Macron dans l’entre-deux-tours.
Ce qu’a réussi Emmanuel Macron s’explique cependant par une volonté de sanction des vieilles pratiques politiques. Comment expliquez-vous la situation de fragilité dans laquelle vous vous êtes retrouvés ?
Pourquoi ça a marché ? Parce que, depuis dix ans, on a eu un président de droite républicaine, Nicolas Sarkozy, qui a tourné le dos à ses valeurs en allant draguer l’extrême droite, et on a eu un président de gauche, François Hollande, qui a été élu sur une politique de gauche et a tourné le dos à des valeurs cardinales sur la déchéance de nationalité et le code du travail.
C’est à partir de ces moments-là que je n’ai plus été d’accord avec ce qui était en train de se passer, alors que j’étais un bon petit soldat. C’est aussi à ce moment que Jean-Pierre Chevènement [nommé à la tête de la Fondation des œuvres de l’islam de France – ndlr] demande aux musulmans de France de se faire discrets. L’étape d’après, c’est quoi ? Que les homosexuels se fassent discrets ? Quelle est cette République qui demande à certains de baisser la tête ? Le fameux « trou de souris » dont j’entendais parler pour François Hollande, finalement c’est son collaborateur qui l’a emprunté, avec 260 000 clics. On était tellement bons stratèges à l’Élysée, à Matignon, à Solférino, qu’il nous est passé devant. Cela en fait-il une règle générale ? Non. Ce n’est pas parce qu’il a réussi son coup magnifique que tout a changé. Je ne crois pas à la fin du clivage gauche-droite.
« Je suis réformiste mais socialiste, je ne suis pas de droite »
Que comptez-vous construire désormais ?
Lorsque le socialiste Defferre a fait 5 % à la présidentielle de 1969, il s’est passé un magnifique congrès à… Alfortville, qui était un prélude à la refondation du PS à Épinay. Dix ans après, le PS a pris le pouvoir. Aujourd’hui, on a besoin de s’adosser sur des politiques publiques efficaces sur les territoires. Notre syndicat social-démocrate en France, ce sont les élus locaux.
Il faut aussi prendre le temps de redéfinir ce qu’on veut faire ensemble. Nous n’avons pas fait ce travail avant d’arriver au pouvoir. Le vendredi qui précédait le premier tour de 2012, je me souviens avoir déjeuné avec Manuel Valls, près du QG de campagne. Il a prononcé une phrase qui m’a hanté durant le quinquennat : « Tu sais, Luc, il y a tellement de sujets qu’on a évoqués dans cette campagne, et dont on a dit : “On gagne d’abord, et on verra ensuite.” » On a vu, et on n’a rien vu surtout : nous n’étions pas prêts. Il ne faut pas revivre les mêmes erreurs.
Alors je m’investis dans le mouvement « Dès demain », dans celui que va lancer Benoît Hamon le 1er juillet – j’y serai –, je veux bien travailler dans la « Movida » de Matthias Fekl. Je sors de neuf ans durantlesquels j’étais le meilleur porte-parole de Manuel Valls. C’est fini. J’ai 46 ans : maintenant, c’est ni Dieu ni maître ! Je veux jouer collectif.
À l’heure où Emmanuel Macron tente de rassembler ceux qu’il appelle les « progressistes », ce qui vous empêche de le rejoindre, c’est donc une fidélité au socialisme ?
Oui. Les ruptures ne se font pas sur la forme, mais sur le fond. J’ai toujours été attaché au PS comme à l’union de la gauche, que j’ai pratiquée, notamment lors des sénatoriales dans mon département. Je ne me suis jamais approché de la « maison des progressistes » qu’avaient promue Gérard Collomb et Jean-Marie Le Guen. Je suis réformiste, mais je suis socialiste, je ne suis pas de droite.
C’est quoi, au fond, être socialiste ?
Je ne veux pas vous faire de grandes phrases… On regarde toujours cela au prisme de ce que l’on est soi-même. François Mitterrand a mis en place les bourses pour étudiants et j’en ai profité pour faire mes études, tout en travaillant par ailleurs. Être socialiste, c’est être pour la liberté et l’égalité pour tous, quels que soient votre champ social, votre origine, vos croyances. Je suis issu d’un milieu d’immigrés grecs, je suis binational, je suis également issu d’une minorité qui s’assume parfaitement, je sais ce qu’on m’a donné… et je sais que les politiques de gauche et de droite, ce n’est pas pareil. Donc il faut se battre.
Comment ne pas être pris en étau entre un centrisme libéral et une gauche radicale, après le score de Benoît Hamon ? Vous avez défendu dans un essai la proportionnelle intégrale, mais le scrutin majoritaire domine encore notre système électoral.
La proportionnelle intégrale, c’est le passe d’entrée vers des coalitions. Il ne peut y avoir de coalitions de projet qu’à la suite d’accords politiques entre partis. Dans ce quinquennat, il y aura peut-être des coalitions sur les textes, les uns après les autres, mais pas des coalitions de projet, comme il y en a eu en Allemagne où les sociaux-démocrates ont obtenu l’introduction d’un salaire minimum au niveau national. Un scrutin majoritaire à deux tours ne pousse pas à cela. Je reste donc favorable à la proportionnelle parce que c’est la plus belle expression du peuple. Il est vrai que cela finira de couper le lien entre le territoire et les assemblées, mais je crois que l’on peut réinventer le rôle du député. Ma conception, c’est d’être député d’Alfortville et de Vitry et d’être député national.
La proportionnelle, c’est aussi une réponse au FN. Assumons de nous confronter à ses élus, projet contre projet. Parce qu’il y a des raisons de fond au vote FN, comme le déclassement, l’absence de services publics ou de commerces de proximité, mais aussi le confort d’un vote à part, qu’on a presque laissé devenir « tendance ».
Mais comment faites-vous pour ne pas être pris dans un étau entre En Marche! et La France insoumise ?
Aux législatives, il y aura clairement des députés de La République en Marche, qu’on ne connaît pas. On peut avoir de très mauvaises surprises, y compris chez moi, tout maire que je suis. Cela dit, je crois au reflux, et qu’au fur et à mesure de l’avancement du quinquennat, les masques vont tomber.
Une bonne partie de l’électorat qui nous a quittés pour voter Jean-Luc Mélenchon est déjà revenue après son refus de soutenir Emmanuel Macron contre l’extrême droite. Il y aura aussi l’échéance des européennes, dans deux ans, lors desquelles nous verrons bien que nous n’avons pas, avec La France insoumise, le même projet pour l’Europe.
En parallèle, nous avons aujourd’hui un chef de gouvernement, Édouard Philippe, qui n’a voté aucune loi de François Hollande. Quant à la société civile, de quelle société civile parle-t-on ? Les syndicats, ce n’est pas la société civile ? On va les écouter en commençant par les ordonnances sur le code du travail ? Moi, je vais servir à faire du fond et à dire les choses. « La marque PS est démonétisée »
Comment analysez-vous le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle ?
Depuis les primaires de la droite et du centre, puis de la gauche, l’idée d’un vote refuge, ou stratège, s’est installée dans l’esprit des gens. À l’automne, il y a quand même eu 600 000 électeurs de gauche qui sont allés voter pour Alain Juppé contre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Je l’ai connu aussi, aux côtés de Manuel Valls, pendant la primaire, quand j’ai vu des Insoumis et des syndicalistes qui venaient voter en masse contre lui. Ces épisodes ont créé une transhumance électorale, ou plutôt, comme on dit chez nous, un ambiancement de vote tactique et stratégique.
Concrètement, à la présidentielle, entre François Hollande et Benoît Hamon, on a perdu 5 000 voix à Alfortville. Si on compare les résultats des autres candidats en 2012 et en 2017, l’équation est simple : la moitié de ces voix se sont portées sur Mélenchon, l’autre moitié sur Macron.
Pendant la campagne, Mélenchon est parvenu à passer devant Hamon dans les sondages… À ce moment-là, il n’incarnait pas autant ce vote stratège. Oui, Jean-Luc Mélenchon a mené une excellente campagne ! Lui et son équipe étaient meilleurs que nous, mieux préparés, plus modernes. Il a fait une campagne plus de gauche sociale-démocrate que radicale à cette présidentielle. Dans un moment où un président de gauche n’avait plus fait une politique de gauche… Mélenchon a capté à son compte l’espoir déçu. Bravo l’artiste !
Vous venez de parler « d’un président de gauche qui n’avait plus fait une politique de gauche ». Vous évoquez la déchéance de nationalité et la loi sur le travail…
Et le CICE ! Il a été imposé par l’énarchie.
Attendez, c’était au début du quinquennat et on vous a entendu le défendre pendant des années
Dans le logiciel qui était alors le mien, je ne voulais pas ajouter du trouble au trouble. Maintenant, j’ai décidé que ma parole était très libre.
Mais vous n’avez jamais été convaincu à un moment que la politique de l’offre pouvait avoir des vertus ? Pendant le quinquennat, des socialistes ont assumé avoir été convertis, en toute sincérité.
Sans doute. Mais pour l’avoir vécu de l’intérieur, nous avons aussi pâti de la guerre des gauches et de querelles internes, y compris au gouvernement. Quand, à la veille du conseil des ministres, Christiane Taubira dit, depuis l’Algérie, que la proposition sur la déchéance de nationalité a disparu, j’apprends le soir même, par François Rebsamen, que le président est très en colère et que, du coup, elle sera dans le texte de loi. C’était aussi une question de rapport de force entre eux, qui a dérapé. Bis repetita sur la loi Travail [entre Valls et Macron – ndlr]. Ça suffit ! Maintenant, il faut être dans la sincérité.
Dans les mois qui viennent, de toute façon, entre la retraite à points, le code du travail ou la taxe d’habitation, le clivage gauche-droite sera redistribué. Il faut simplement que nous soyons prêts. Avec des expériences originales, venant du local, avec des parlementaires expérimentés et des visages nouveaux, pour offrir à la gauche une nouvelle donne.
Cette nouvelle donne passe-t-elle par le PS ?
Pas seulement.
Votre premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis a dit que le PS était mort. Êtes-vous d’accord ?
Cela ne se fera pas du jour au lendemain. La gauche doit, si elle veut séduire à nouveau, moderniser sa marque. Cela peut passer par le changement du nom du PS, mais pas par le changement de l’histoire et des valeurs.
Faut-il aussi en changer les contours ?
Quand j’ai vu l’UMP devenir Les Républicains, j’ai pensé que le FN allait s’appeler le parti des patriotes. Pourquoi nous, le môle central, ne serions-nous pas le parti des démocrates ? Dans les démocrates, je mets tous les progressistes, les réformistes, le canal historique du PCF, les écologistes, les radicaux…
Mais aussi les citoyens, les associations et les syndicats. Comme maire, je suis en permanence dans la co-construction avec les associations, les partis, des comités de quartier, les syndicats, les personnels communaux… Pourquoi ne pourrait-on pas le faire dans un parti politique ?
Pour cela, il faut créer une belle maison commune, de gauche, qui donne envie. Elle ne peut pas être sectaire et elle doit être sincère.
Si on élargit le spectre, la social-démocratie est en difficulté partout en Europe. Et quand elle essaie de se réinventer, comme au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne, soit elle évolue de plus en plus vers la droite, soit elle se radicalise à gauche. Où vous situez-vous dans cette évolution ?
Quand cela prend le chemin que je décris, comme en Allemagne, cela n’a pas l’air de marcher [le SPD vient de subir une nouvelle claque électorale – ndlr]… De toute façon, c’est le môle central qu’il faut réinventer. Je n’ai pas aujourd’hui le mode d’emploi.
Mais j’ai une certitude : le socle à partir duquel il doit partir. Ce socle, c’est l’histoire, l’union de la gauche, et les expériences des politiques publiques dans les territoires.
Mais j’ai aussi un petit côté bonapartiste – sinon, je n’aurais pas été vallsiste un jour ! Je pense donc qu’il faut des incarnations. C’est ce qui nous va manquer dans les prochaines semaines. Pour les législatives : LR a Fillon, Sarkozy ou Baroin ; LREM a le président ; La France insoumise a Mélenchon. Nous, nous n’avons personne. Sans incarnation et avec une marque démonétisée, nous risquons d’être en grande difficulté.
Si nous parvenons à conserver, avec sincérité et fidélité, nos valeurs, et notre histoire, pour la faire rebondir, en expliquant pourquoi nous sommes de gauche, avec une co-construction ouverte, non sectaire, d’un grand mouvement démocrate, nous serons au rendez-vous dans cinq ou dix ans. Mais en attendant, je ne vais pas rester tétanisé. Il y a du boulot.
Entretien avec Guillaume Balas à retrouver sur Médiapart